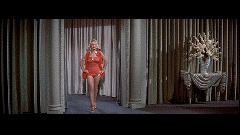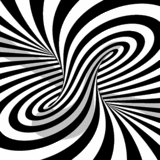-
Par Dona Rodrigue le 11 Février 2013 à 00:32

PORTRAIT DE JEAN-PIERRE MELVILLE A TRAVERS SES FILMS
Né en 1917, Jean-Pierre Grumbach s'engage à 23 ans dans la Résistance avant de rejoindre les Forces Françaises Libres. Il est connu sous le pseudonyme de "Melville", choisi en hommage à son écrivain favori. C'est sous ce nom qu'il marquera de son empreinte le cinéma français des années 50 à 70.
Jean-Pierre Melville fait office de chaînon manquant entre le cinéma français d'avant-guerre et la Nouvelle Vague. Son œuvre marque aussi bien les cinéastes de la Nouvelle Vague (Godard le nomme parrain du mouvement, et Melville fait une courte apparition dans A bout de souffle) que des réalisateurs comme Quentin Tarantino, Michael Mann, John Woo, Johnnie To ou les frères Coen (qui signent avec Miller's Crossing le plus beau descendant du cinéma melvillien).
Il s'illustre brillamment dans des adaptations de romans (Vercors, Cocteau, Kessel...) mais surtout révolutionne le cinéma policier français en le portant vers une abstraction jusqu'ici jamais atteinte, et qui rapproche parfois son cinéma de celui de Michelangelo Antonioni. Melville est aussi perfectionniste dans la fabrication de sa propre image (lunettes noires, Stetson et Rolex) que lorsqu'il s'agit de mettre en scène un film, sa maniaquerie devenant légendaire tout comme son anxiété et son angoisse constante.
Après les immenses succès populaires du Deuxième souffle et du Cercle rouge, l'échec public d'Un flic le terrasse physiquement et il est emporté moins d'un an après la sortie du film par une rupture d'anévrisme. Jean-Pierre Grumbach n'était âgé que de cinquante six ans.
Nous vous proposons dans ce dossier de retracer la carrière de cet immense cinéaste à travers ses différentes réalisations.

Après l'armistice de 1940, un vieil homme vit retiré à la campagne avec sa nièce. Ils se voient contraints par la Kommandantur d'héberger un officier allemand. Bien décidés à ne pas parler à ce représentant des forces d'occupation, il l'accueillent dans une maison aussi froide et silencieuse qu'un tombeau. Cependant, au fil des visites de von Ebrennac - qui, chaque soir, fait un court passage dans le salon et livre ses pensées à ses hôtes - ils découvrent un homme intelligent, sensible et sincèrement amoureux de la France. Il leur raconte sa passion pour la musique et la culture en général, sa conviction profonde que de cette guerre va naître un rapprochement des peuples. L'oncle et la nièce gardent le silence mais sont troublés par cet homme qui leur parle sans attendre de retour de leur part, qui comprend et approuve même leur résistance silencieuse...

Jean-Pierre Melville tourne cette adaptation de Vercors, un court texte publié clandestinement sous pseudonyme en 1941, dans la maison même qui a été le modèle de l’écrivain. Le cinéaste a servi dans les Forces Françaises Libres et il reviendra à cette période de l'histoire française avec Léon Morin, prêtre et bien entendu L'Armée des ombres d'après Joseph Kessel. C'est une absolue nécessité de témoigner de cette période qui le pousse à réaliser ce premier film qu'il écrit, met en scène, monte et produit avec un budget extrêmement réduit, sans recevoir l'autorisation du CNC ni même celle de Vercors.
Le film offre un vrai parti pris qui est celui d'une narration continue, avec d'une part les "interminables monologues" du lieutenant allemand (Howard Vernon, que l'on retrouvera dans des petits rôles dans Bob le flambeur et Léon Morin, prêtre) - comme l'exprime l'oncle (Jean-Marie Robain qui jouera dans Les Enfants terribles, Bob le flambeur et L'Armée des ombres) - et d'autre part la voix off de ce dernier. Ce dispositif répétitif, qui pourrait être redondant, est important car il porte le sous-texte de l'histoire.
Ainsi, c'est la voix off qui répond aux monologues de von Ebrennac, ce dernier n'attendant pas de réponse de ses hôtes forcés, tellement silencieux que l'on ne connaît même pas leurs noms. L'oncle et sa nièce (Nicole Stéphane, la Elisabeth des Enfants terribles) refusent de parler mais sont bientôt pris de remords alors qu'ils découvrent l'humanité de leur "invité". Mais ils sont enfermés dans rôle qu'ils se sont engagés à tenir et ne peuvent plus faire un pas vers von Ebrennac. Or si les personnages ne se parlent pas à l'écran, s'ils restent chacun dans leurs mondes respectifs, ils se parlent par le biais du cinéma.
Il y a une troisième voix qui est la musique. Si celle-ci est envahissante, elle traduit en sensations le contenu de cet échange silencieux. Lorsque von Ebrennac joue le 8ème prélude de Bach au piano et que tous restent silencieux, le thème est ensuite repris dans la partition du film, musique qui se transforme et épouse la réflexion de l'officier qui explique sa vision d'une musique à hauteur d'hommes. Plus tard, l'oncle joue les premières mesures du morceau, comme un appel pour que von Ebrennac revienne les voir après une semaine de silence.
Si le film repose beaucoup sur la parole et la musique, Melville fait preuve pour cette première réalisation d'une mise en scène fine et précise, utilisant les cadres et les jeux de lumière (la photographie est signée du grand Henri Decae, qui restera un fidèle du cinéaste) pour montrer l'évolution des rapports entre les personnages. Lorsque Walter von Ebrennac apparaît pour la première fois dans le film, c'est dans l'encadrement d'une porte, apparition effrayante à la Frankenstein soulignée par une lumière rasante qui épouse sa silhouette alors que le reste de la pièce est plongée dans l'obscurité.Il est pendant longtemps cadré en contre-plongée, puis la caméra se déplace au fil de ses visites pour finalement se mettre à hauteur de ses yeux. De même, pendant longtemps il ne partage pas le cadre avec ses hôtes, jusqu'à ce que les liens se créent et que Melville lie les trois protagonistes dans un doux mouvement de caméra. Dans ce film très poétique, le cinéaste utilise les paysages hivernaux et la figure du huis clos pour exprimer métaphoriquement ce qu'a subit la France sous l'Occupation.
Avec ce film tourné quatre ans après la Libération, Melville réalise à la fois une ode à la Résistance et un bouleversant appel à faire un pas vers l'autre, à dépasser les préjugés. La première parole prononcée par la nièce se situe à une heure de film, un simple « Il va partir ». Phrase tout juste suivie par les premières paroles de l'oncle adressées à von Ebrennac : « Entrez, monsieur. » L'oncle et la nièce acceptent enfin de voir l'homme derrière l'uniforme, et ce au moment où von Ebrennac découvre de son côté le vrai visage du nazisme.Il a vécu l'échec de la république de Weimar à travers le désespoir de son père, et s'il appuie l'occupation allemande c'est qu'il croit que c'est de là que viendra l'unification de l'Europe. Mais au cours d'un voyage à Paris, il découvre auprès d'un autre officier l'existence de la Shoah et la volonté de ses pairs d'effacer toute trace de l'ancienne France qu'il aime tant. Von Ebrennac demande alors à ses hôtes d'oublier ses discours idéalistes, leur dit qu'il a compris que l'Allemagne est une nation qui a sombré dans l'horreur et la barbarie.
Il se porte volontaire pour partir sur le front de l'Est (geste de rédemption par le suicide) et, au moment de partir, la nièce lui adresse un « adieu » vibrant. La caméra cadre le motif de son gilet : deux mains tendues l'une vers l'autre, celles de « La création d'Adam » de Michel-Ange. Rien n'a pu se dire verbalement entre eux mais le cinéma a su créer du lien, de l'émotion, de la parole au-delà des mots. Le Silence de la mer est un film envoûtant, d'une intense beauté et d'une infinie humanité.
O.B.
Paul et Elisabeth, deux adolescents vivant chez leur mère mourante, sont frère et sœur et entretiennent des rapports singuliers. Inséparables, ils vivent dans la même chambre et passent leur temps à s’invectiver et à jouer à des jeux insolites et provocateurs. Après une blessure occasionnée lors d’une bataille de boules de neige dans son lycée, Paul doit rester alité sous la protection de sa sœur. Cette cohabitation troublante se poursuit après le decès de leur mère, et le mariage d'Elisabeth avec un jeune et riche homme d’affaires au destin funeste. Viennent les rejoindre dans la grande demeure héritée de feu son mari, Gérard, le meilleur ami de Paul, et Agathe, rencontrée dans une agence de mannequins. Quand Elisabeth apprend que Agathe et Paul sont amoureux l’un de l’autre et souffrent en silence, la relation fraternelle vire au psychodrame.
Les amateurs du cinéma de Jean-Pierre Melville risquent fort d’être déstabilisés à la vision de ce film étrange qui doit autant, sinon plus, à Jean Cocteau qu’au réalisateur du Samouraï. Il serait donc judicieux de mettre un temps de côté les films policier de Melville, qui ont fait sa renommée, avant de se pencher sur ces Enfants terribles et de se livrer à des comparaisons farfelues.
C’est Jean Cocteau, pris par la préparation de son Orphée et admiratif du Silence de la mer (1948), premier film du cinéaste, qui fit appel à ce dernier pour adapter à l’écran son propre roman paru en 1929. Cette collaboration ne se passa pas sans heurts, comme semble le démontrer le résultat mitigé de ce travail en commun.
Les relations furent donc plutôt tendues entre Jean Cocteau et Jean-Pierre Melville. Par exemple, l’écrivain imposa l’acteur principal au réalisateur qui le trouvait trop âgé et physiquement inadapté pour le rôle de Paul. De même, Melville dut se battre contre l’avis de Cocteau pour confier le rôle d'Elisabeth à Nicole Stéphane, son actrice du Silence de la mer.
La musique fut aussi un point d’achoppement, et Melville eut le dernier mot en optant pour deux compositions classiques (les concertos de Bach et Vivaldi), un choix qui se révéla d’abord fort judicieux pour souligner le caractère obsessionnel du récit, et surtout précurseur en la matière. Le tournage lui-même fut également mouvementé. Il est probable que l’une des conséquences malheureuses de ce conflit larvé soit le jeu passablement figé et légèrement caricatural des comédiens en général.
Jean-Pierre Melville a recours a des angles parfois insolites, des recadrages signifiants et quelques mouvements de caméra portée insidieux pour mettre en évidence l’intimité froide et pathologique entre ces deux jeunes adultes, ainsi que l’atmosphère glaciale qui baigne les décors.
La lumière de Henri Decae, un directeur de la photographie qui joua un grand rôle dans les innovations amenées par la Nouvelle Vague, participe de cette étrangeté visuelle en jouant sur l’équilibre entre les clairs-obscurs et la dureté de l’éclairage, et sur la perspective des décors intérieurs. Le revers de la médaille de ce système figé dans cette description cauchemardesque d’une réalité faussée par ses principaux protagonistes est une certaine théâtralité qui peut devenir pesante quand tous ses principaux éléments caractéristiques (voix off, dialogues, interprétation) fonctionnent à plein régime.
R.C.
Bob le flambeur (1956)
Robert Montagné (Roger Duchesne), dit "Bob le flambeur", est un truand retiré des affaires qui passe ses journées sur les champs de courses et ses nuits dans les tripots. Il apprend que le coffre du Casino de Deauville contiendrait huit cent millions de cash à la veille du Grand Prix. Il décide de monter son dernier grand coup...
Bob le flambeur, premier film policier de Jean-Pierre Melville, ne préfigure pas encore sa relecture personnelle du genre qui démarrera véritablement à partir du Doulos. Melville ne considérait d'ailleurs pas Bob le flambeur comme faisant partie du genre, mais comme étant une "comédie de mœurs". Effectivement, le cinéaste suit avec un mélange de fascination et de tendresse ce personnage de vieux criminel qui ne croit plus en rien, plus même en lui. Intelligent, solitaire, marginal, dandy... Bob est le premier grand héros melvillien et, pour l'incarner, il fait appel à Roger Duchesne, un acteur qui eut une petite carrière de jeune premier dans les années 30 avant de s'acoquiner avec le milieu et d'être arrêté en 1944 pour avoir collaboré avec l'occupant.

L'interprète parfait en somme pour interpréter le héros vieillissant d'une intrigue qui rappelle celle de Du rififi chez les hommes, un film que Melville devait mettre en scène mais qui échut finalement à Jules Dassin (gentleman, ce dernier s'assura auprès de la production que son confrère soit payé comme le prévoyait le contrat). La ressemblance n'est pas le fruit du hasard, Auguste Breton - auteur de Rififi mais aussi de Razzia sur la Chnouf - ayant écrit le scénario avec Melville.
Le cinéaste semble ne s'intéresser que de très loin au récit, préférant s'attacher à son personnage et filmer les lieux. Il s'écarte sciemment des codes du genre et signe à ce titre une fin très ironique, retournant les enjeux du cinéma policier comme un gant et prenant à rebrousse-poil les attentes du spectateur. Il transforme ainsi une intrigue policière simple et classique en une traversée poétique de Montmartre et du monde de la pègre parisienne. Cette promenade jazzy est par ailleurs très réaliste, le cinéaste s'évertuant à évacuer tout pittoresque au profit d'une recherche d'authenticité.Ayant longtemps habité le quartier de Montmartre, vécu au contact de la faune de Pigalle, observé les us et coutumes de ce petit monde, il puise dans cette expérience et parvient à nous faire partager l'atmosphère si singulière dans laquelle baignent ces quartiers interlopes. On sent constamment que Melville sait de quoi il parle, qu'il connaît le langage, le rythme, les codes de cet univers.
Avec l'aide du grand chef opérateur Henri Decae, il nous donne à ressentir la ferveur ou la langueur des nuit parisiennes, l'ambiance des petits matins au moment où les oiseaux de nuit regagnent leur refuge alors que la bonne société s'éveille. Jean-Pierre Melville tourne ce film avec très peu de moyens, et le ton si singulier qui s'en dégage marque les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague qui le citeront souvent comme un exemple et comme une œuvre précurseur de leur mouvement.
O.B.
Deux hommes dans Manhattan (1959)
Fèvre-Berthier, un délégué français à l'ONU, manque à l'appel lors de l'Assemblée de ses représentants à New York. Le patron de l’agence new-yorkaise de l'AFP met le journaliste Moreau (Jean-Pierre Melville) sur le coup. Ce dernier impose de mener l’enquête avec Delmas (Pierre Grasset), un photographe alcoolique détesté de la profession. Mais comme le dit Moreau à son chef : « Tu me demandes de faire le policier, alors laisse moi recruter mes indicateurs librement. » Les deux hommes parcourent la ville en suivant les quelques pistes laissées par le délégué disparu...
Alors qu'il est un amateur absolu du cinéma américain, Melville n'a jamais eu l'envie de tourner un film aux États-Unis et, s'il est tourné à New York, Deux hommes dans Manhattan reste une production entièrement française. Le film repose sur une approche presque documentaire de la ville, chose assez rare dans le cinéma de Jean-Pierre Melville même si l'on trouve dans Bob le flambeur et ses autres réalisations quelques scènes de rues qui portent la marque du cinéma du réel. Pendant les trois semaines de tournage dans la ville, Melville et ses acteurs improvisent constamment.
La petite équipe (ils sont cinq au maximum) arpente les rues et tourne de nombreuses scènes à la sauvette. L'intrigue du film n'est qu'un prétexte que Melville se donne pour nous embarquer à ses côtés dans une balade new-yorkaise.
C'est la première fois que le cinéaste pose les pieds en Amérique mais il connaît New York comme sa poche, ayant étudié en amont l’emplacement de chaque rue, la vie de chaque quartier. Il s'extasie devant le studio Capitol, Broadway, filme les rues, les théâtres, les clubs de jazz avec un regard d'enfant émerveillé. Comme dans Bob le flambeur, l'intrigue est ici distendue, reléguée au second plan, le récit s'écartant de la route attendue de l'enquête policière.Melville se promène, tout en parlant de ces choses qui lui tiennent à cœur et qui reviendront tout au long de sa filmographie comme la Résistance, l'amitié (les relations entre Moreau et Delmas préfigurent celles de Reggiani et Belmondo dans Le Doulos), la trahison ou le rêve mélancolique d'une époque passée. Lorsqu'un représentant du gouvernement français regrette les politiciens d’avant-guerre, ceux des Roaring 20’s, on voit déjà Melville s'inventer cette nostalgie d'un monde idéalisé qui nourrira ses futures réalisations. Une nostalgie bien prégnante également lorsqu'il s’attache à filmer d'anciens becs à gaz perdus au milieu des architectures modernes. Melville ne connaît l'Amérique qu'à travers le cinéma, les films noirs, et il ne trouve dans la réalité que quelques signes épars qui lui rappellent son New York de rêve.
Le cinéaste s’amuse et joue avec les motifs du film policier américain et, comme dit la secrétaire de Fèvre-Berthier, il faut « chercher la femme » pour dénouer le mystère, comme dans tout bon noir qui se respecte. Melville est déjà dans le méta cinéma comme le montre la façon dont il filme son entrée, se cadrant de dos, faisant longtemps patienter le spectateur alors qu’il recouvre sa machine à écrire, remet sa veste et son chapeau, se sert un verre d’eau... avant enfin de faire face au spectateur. Sur un ton humoristique, Melville montre déjà cette tendance à jouer sur l’iconisation et les mythes cinématographiques. Il utilise les codes du genre avec une tendresse un peu teintée d'autodérision (ce qui disparaîtra dans ses œuvres futures), comme l'attestent les éclats des cuivres qui ponctuent les quelques révélations de l'intrigue.Deux hommes à Manhattan est un film plein de défauts, bricolé, souvent mal maîtrisé, mais à l'atmosphère incroyable. Melville parle à travers de ce film de son amour pour l'Amérique et son cinéma. Il se place dans le courant naissant du cinéma indépendant américain, ce cinéma léger qui approche de façon documentaire la société, tout en rendant hommage au cinéma classique hollywoodien. Après avoir annoncé la Nouvelle Vague avec Bob le flambeur, Jean-Pierre Melville semble alors faire pleinement partie de ce mouvement qui débute vraiment en 1958 et 1959. La suite de sa carrière fera mentir cette prédiction.
O.B.
Léon Morin, prêtre (1961)
1940, en France occupée. Après la disparition de son mari juif, Barny trouve refuge avec sa fille France dans une petite ville des Alpes. Elle est un peu excentrique, fort en gueule, communiste et courageuse mais pour protéger France, elle décide de la faire baptiser. Au contact de l'église, la bouffeuse de curé se réveille et elle s'en va provoquer un prêtre de la paroisse en lui déclarant dans le confessionnal que « la religion c'est l'opium du peuple ! » Mais elle se retrouve face à l'abbé Morin (Jean-Paul Belmondo), qui la déstabilise en en rajoutant sur sa déclaration. Léon Morin n'est pas un abbé comme les autres : il cache des Juifs, fustige le décorum bourgeois de l'Eglise et prône la vraie foi. Après cette rencontre, Barny retrouve chaque soir Morin pour parler de la foi et de l'engagement religieux, et bientôt les croyances de Barny vacillent...
Dès la parution du roman de Béatrix Beck, Prix Goncourt en 1952, Jean-Pierre Melville souhaite en faire une adaptation cinématographique. Il lui faut attendre huit ans avant de parvenir à concrétiser ce projet car il s'agit d'abord pour lui de trouver les interprètes idéals. Si ce projet se concrétise enfin, c'est que Melville - qui vient d'acquérir ses propres studios, rue Jenner à Paris - a rencontré Jean-Paul Belmondo. Il sent tout de suite chez l'acteur une immense présence, sait qu'il est un grand comédien, et sa prestation dans Léon Morin, prêtre lui donne entièrement raison.

Pour incarner Barny, Melville choisit Emmanuelle Riva (qu'il a découverte dans Hiroshima mon amour) car elle ressemble physiquement à Béatrix Beck. Heureusement, il n'y a pas que l'apparence et l'actrice est littéralement éblouissante dans ce rôle, nous charmant par ses irrésistibles moues, nous faisant fondre par ses regards tristes. Sorte de lutin espiègle, elle entraine avec elle le film, Léon Morin, prêtre étant derrière son titre austère une œuvre drôle et enlevée, portée par des dialogues savoureux et l'humour de la mise en scène.

Celle-ci est d'une grande inventivité, Melville ne se contentant pas de signer une reconstitution appliquée ou une adaptation littérale du texte. Mouvements de caméra (un défilé de soldats allemands est mis en scène comme un viol de l'héroïne par une succession de brusques travellings avants vers celle-ci), symbolique de l'image (l'entrée des soldats dans la ville assoupie avec simplement des bruits de bottes en fond sonore, et à l'écran les volets clos d'une fenêtre couverte d'un rideau dont les motifs représentent une meute de loups), effets de montage ironiques (la musique de foire qui accompagne les soldats italiens et leurs drôles d'uniformes et qui se fait martiale lorsque ceux-ci croisent des Allemands)... chaque séquence est l'occasion pour Melville d'innover et de chercher cinématographiquement à faire ressortir les enjeux du récit, qu'ils soient historiques, humanistes ou philosophiques.
Les joutes verbales entre Morin et Barny sont ainsi l'occasion pour le cinéaste de travailler savamment la disposition des personnages dans le cadre, Melville signant une série de scènes admirables qui épousent le plaisir de la maïeutique. Les réflexions théologiques et philosophiques virevoltent et se révèlent légères, portées par le charme, l'humour et l'engagement du couple d'acteurs.
Le film est ainsi à la fois la chronique d'une petite ville sous l'Occupation, un récit initiatique (l'histoire d'une conversion qui est aussi la partie la moins enthousiasmante du film), une comédie de mœurs et un drame. Dans la version originale qui faisait plus de trois heures, Melville s'attachait encore plus à Barny et reléguait Léon Morin à l'arrière-plan. Mais même en l'état, c'est un magnifique portrait de femme, le seul film - avec Les Enfants terribles - de Jean-Pierre Melville vu à travers les yeux d'un personnage féminin.
La sensibilité du cinéaste s'exprime pleinement dans la bouleversante dernière partie, où Barny s'enfonce dans le malheur car elle espère que Léon Morin est un homme qui pourrait accueillir son amour alors qu'il est tout entier à Dieu. L'impossibilité de l'amour est, avec la solitude, le grand thème melvillien et Léon Morin, film passionnant et d'une grande richesse, est loin d'être un accident de parcours comme on a pu le lire ça et là, mais fait pleinement partie d'une œuvre d'une rare cohérence.
O.B.
Le Doulos (1962)
Maurice (Serge Reggiani) vient de sortir de prison après cinq années d’incarcération. Il retrouve son ancien receleur qui le met sur le casse d’une maison. Maurice accepte le contrat mais abat l’homme d’une balle, s’emparant des bijoux d’un autre casse et d’une liasse de billets. Le lendemain soir, il se rend avec un complice dans la demeure après que sa maîtresse Thérèse (Monique Hennessy) ait fait des repérages dans la journée. Mais alors qu’ils sont en train de percer le coffre, la police intervient. Son comparse est abattu et Maurice, qui a pourtant toujours refusé de porter une arme à feu lors d’un casse, se voit contraint de tuer un inspecteur. Blessé, il s’effondre dans la rue et se réveille dans l’appartement de son ami Gilbert (René Lefèvre). Malgré l’interdiction du médecin qui est venu lui retirer la balle, il quitte le lit pour retrouver Silien (Jean-Paul Belmondo) qu’il pense être « Le Doulos » (l’indic) qui l’a vendu aux flics…
L’univers de Jean-Pierre Melville est celui du cinéma policier et même s’il a su exprimer son talent hors de ce genre, c’est bien en travaillant en son sein qu’il a livré ses plus éblouissantes réussites. Après Bob le flambeur et Deux hommes dans Manhattan, il revient au policier avec ce Doulos, bénéficiant d’un budget plus important, d’un casting de premier choix et d’une grande liberté artistique que lui confère la création de ses propres studios. Dans ce film qui ouvre son grand cycle criminel, on trouve tous les ingrédients qui feront du Samouraï, du Deuxième souffle ou du Cercle rouge des chefs-d'œuvre du genre. Maîtrisant parfaitement les codes du cinéma noir américain, il parvient à les utiliser si finement que jamais on n’a l’impression d’assister à un quelconque décalque francisé.
On trouve ainsi toute la panoplie du film noir (les ruelles désertes, les virées nocturnes, les imperméables, les chapeaux de feutre…) ; et même si Melville rejette toute forme de naturalisme, préférant utiliser les icônes, les mythes et l’abstraction, l’univers qu’il dépeint semble si naturel, si vrai que l’on a l’impression d’être plongé dans le monde la pègre parisienne. Rien ici n’est appuyé, tout semble couler de source à l’image d’une mise en scène si fluide et si évidente qu’elle masque la méticulosité et la précision constante dont fait preuve le cinéaste.
Tout l’univers de Melville est donc là. Un univers masculin où l’amitié, la dignité et la droiture priment sur tout le reste (la réussite ou l’échec d’un casse par exemple) et doivent se retrouver dans chacun des gestes, chacun des actes des personnages. Ceux-ci sont profondément "melvillien" dans leur allure, leurs codes vestimentaires, leur façon de se tenir, l’apparence physique et les actes allant toujours de pair dans son cinéma. La précision et le calme des gestes reflètent ainsi la rigueur des personnages, leur nécessaire détachement, leur attention constante.Des personnages toujours ambigus, dont on ne sait s’ils sont des traîtres ou de fidèles compagnons. La pègre selon Melville est un fantasme, et il ne faut pas chercher une quelconque vérité sociologique dans ses films. Il rêve d’un monde criminel pur qui serait le seul endroit où l’honneur primerait sur l’argent et le pouvoir. S’ils font des casses, ils n’ont cure du gain : c’est pour le jeu, pour la beauté du geste, c’est un moyen de tester leur courage, leur loyauté, leur amitié.
Mais même dans ce rêve de pègre, la cupidité, le goût du pouvoir ou la peur de certains obligent les héros "melvilliens" à naviguer dans des eaux troubles où rien n’est jamais acquis. L’intrigue du Doulos exprime parfaitement cette vision d’un monde clos visant à un idéal, mais qui se trouve être corrompu par certains de ses acteurs. Chaque personnage est ainsi ambivalent et le doute imprègne chaque minute du film. Avec ce jeu du chat et de la souris surprenant, ludique et cérébral, Jean-Pierre Melville trouve une expression parfaite de sa vision fantasmée du monde et de ses questionnements moraux qui s’écartent de la traditionnelle séparation entre le bien et le mal. Magistral.
O.B.
Le Deuxième souffle (1966)
A 46 ans, après dix ans de taule, Gustave Minda (Lino Ventura) s'évade et reprend contact avec ses anciens complices et découvre de nouvelles règles du jeu. Le commissaire Blot (Paul Meurisse), témoin ironique de l'avènement d'un nouveau monde criminel, profite de la disparition de la loi du milieu pour mener à bien ses enquêtes. Orloff (Pierre Zimmer), Jacques Le Notaire, Manouche (Christine Fabréga) et Alban (Michel Constantin) font partie de la vieille école. Jo Ricci (Marcel Bozzuffi) est lui un nouveau gangster, sans code de l'honneur, sans morale, juste attiré par l'argent et le pouvoir. Le Notaire se fait assassiner lors d'un règlement de comptes, et Minda intervient juste à temps alors que deux malfrats s'en prennent à Manouche et Alban. Comprenant que ce monde n'est plus fait pour lui, il décide de gagner l'Amérique. Mais avant, il accepte un dernier coup avec Paul, le frère de Jo Ricci. Le coup réussit mais ils sont dénoncés à la police par un indic qui fait porter le chapeau à Gu. Arrêté par la police, manipulé, il passe aux yeux de tous comme le traître qui a vendu ses complices...
En adaptant un roman de José Giovanni, Jean-Pierre Melville ne s'intéresse absolument pas à une vision réaliste du monde du crime. C'est un monde de fiction qu'il invente et Gu Minda n'a rien en commun avec Auguste Mella, le véritable bandit qui a inspiré le roman. Melville suit la disparition de ces dinosaures, les filmant avec la même dignité que celle qui régit les actes de ses personnages.

Une phrase, placée en exergue du film, dit tout de sa morale : « A sa naissance, il n'est donné à l'homme qu'un seul droit : celui de choisir sa mort. Mais si ce choix est commandé par le dégoût de la vie, alors son existence n'aura été que pure dérision. » Tous les membres de l'ancienne garde se savent condamnés à la disparition : Blot pousse Manouche à changer de vie, mais elle considère qu'il est trop tard ; ailleurs, il est dit que « Gu n'a pas suivi l'évolution, il a les anciennes idées et ça peut prêter à conséquence... » Ce dernier, grand héros melvillien se sait condamné, et tout ce qui importe pour lui est de partir avec dignité. Lorsqu'il est accusé d'avoir vendu ses complices aux flics, Gu ne peut que se sacrifier pour prouver son honneur.
Cette obsession pour l'honneur, la droiture, la fidélité vient certainement en grande partie du passé de résistant de Melville. On peut ainsi sans peine faire un rapprochement d'un côté entre la Résistance - avec son lot d'actions parfois criminelles - et les héros de ses films policiers, de l'autre entre les truands sans honneur - qui n'hésitent pas à collaborer avec la police ou à trahir leurs pairs - et les collaborateurs de la France de Vichy. Lors du tournage, Melville aurait dit à Ventura : « Là, vous êtes Gerbier »... Gerbier, le héros de la Résistance que va incarner l'acteur dans L'Armée des ombres.Le scénario en lui-même est très classique. Le cinéaste se plaît à accumuler toutes les scènes clefs du genre policier : évasion, règlements de comptes, jeu du chat et de la souris avec l'inspecteur, filatures, mises sur écoute, préparation d'un braquage, exécutions sommaires... L'intérêt n'est pas dans cette intrigue, mais dans la façon dont Melville met en scène ses personnages et place le film sous le signe de la fatalité. Melville mène ce chant du cygne en faisant avancer implacablement l'intrigue, rythmée à l'écran par des indications temporelles. Les évènements s'enchaînent de façon inexorable, jusqu'à un dénouement que l'on sait fatal dès les premières images du film.
Il met en scène son récit policier en jouant sur la dilatation de l'intrigue, donnant tout l'espace nécessaire à ses personnages. Ainsi, il les magnifie, leur donne de la grandeur, de la noblesse. Toutes choses qui viennent aussi de son goût pour l'underplay des acteurs qui doivent tout faire passer par leur attitude et leurs gestes.Melville n'est pas dans l'iconisation absolue du Samouraï, du Cercle rouge ou d'Un flic, Le Deuxième souffle restant encore ancré dans une tradition du film policier qui repose sur les dialogues et l'intrigue. Mais sa façon de décrire les relations entre les personnages et leur rapport à la morale à partir d'une simple accolade, d'une poignée de main, d'un échange de regards, annonce l'abstraction de ses futures réalisations. Le Deuxième souffle est une magnifique tragédie avant d'être un film policier, une œuvre charnière dans la carrière de l'un des plus grands cinéastes français d'après-guerre.
O.B.
Jef Costello est un tueur à gages. Il exécute ses contrats froidement, de la façon la plus anonyme possible. Il n’a nulle existence en dehors de sa profession. A la suite du meurtre d’un gérant de boîte de nuit, il est arrêté par la police parmi d’autres suspects. Les témoignages étant contradictoires, il est relâché. Mais les commanditaires du meurtre préfèrent ne pas prendre de risques et tentent d’éliminer leur employé.
Comment aborder aujourd’hui Le Samouraï ? Car il ne s’agit pas seulement du point culminant de l’œuvre de Melville, ni même d’un simple chef-d’œuvre d’un sous-genre - le film noir à la française en l’occurrence. Le Samouraï est plus que tout cela : c’est une synthèse, un pivot, tout ce qui a précédé mène à lui, ce qui suivra en découlera. Héritier ingrat et infidèle du Film Noir américain, celui que Melville vénère, celui de Quand la ville dort, du Coup de l’escalier et quelques autre encore, il influencera tous ceux qui se risqueront dans le polar, en particulier du côté du continent asiatique, les citer tous serait fastidieux - à ce propos, dissipons une légende : si Chow Yun-Fat s’appelle Jef dans The Killer, c’est dû à une invention de l’auteur des sous-titres anglais, non à une volonté d’hommage à Melville - le film s’en charge très bien lui-même.
Jusqu’au Deuxième souffle, Jean-Pierre Melville réalisait des films. A partir du Samouraï, il produira des films de Melville. Le style jusqu’à présent en gestation parvient enfin à maturité, l’adjectif "melvillien" fait son entrée dans les dictionnaires de cinéma et son système se met en place, et tournera jusqu’à s’étouffer lui-même, mais ceci est une autre histoire. Jusqu’à présent, Melville subissait l’influence de ses maîtres ; il s’en affranchit avec Le Samouraï. Il prend ce qui l’intéresse, que ce soit dans le Film Noir ou le chambarra. Peu importe que l’essence du genre se perde parfois en chemin, ce qui intéresse Melville, c’est parfois une simple iconographie.
Le ton est d’ailleurs donné par la phrase d’introduction : le réalisateur crée son propre Bushido pour le faire correspondre à l’histoire qu’il a imaginée. Il n’a que faire du code d’honneur des sabreurs nippons, ce qui l’intéresse, c’est la figure du loup solitaire et blessé. Melville se sert dans ce qu’il croit, ou surtout veut comprendre du genre. Jusqu’à présent sous-jacente, l’abstraction fait son entrée dans le système Melville. Elle ne domine pas encore le film dans sa totalité, ce qui sera le cas dans les derniers films. Il y a donc encore de la vie dans les rues de Paris, du côté de Jourdain ou du Châtelet, où l’on retrouve des traces de Bob le Flambeur.
Il en va autrement des intérieurs, qui eux semblent presque conçus pour le théâtre : la chambre de Jef est ascétique au possible, ne comprenant comme mobilier que le strict minimum ; seule la présence de l’oiseau en cage apporte de l’humanité à l’ensemble. Le 36 Quai des Orfèvres ne semble composé que de couloirs gris-vert éclairés de néon, à l’exception du bureau de François Perrier - mais la carte du Paris ancien affichée au mur en témoigne, cet homme appartient à une autre époque. Enfin, le club de jazz ressemble à tout sauf à une cave enfumée ; Ginette Vincendeau note d’ailleurs très justement que lors du dernier plan, les musiciens débarrassent la scène de leurs instruments tandis que les spectateurs quittent la salle.Ces lieux sont donc des espaces artificiels où se jouent les principaux actes de la tragédie, les personnage ne passent par les espaces réels que le temps de se rendre d’un décor à l’autre. Par ailleurs, Melville n’a que faire du réalisme ou de la vraisemblance - imaginerait-on dans la réalité un tel déploiement de forces de police pour filer un simple suspect ? : ainsi, lors des deux meurtres à bout portant commis par Costello, le premier plan montre celui-ci les bras croisés devant lui. Le plan suivant montre sa victime s’emparant d’une arme, puis raccord sur le pistolet de Jef faisant feu, sans qu’on l’ait vu dégainer.
Melville joue du temps et de l’espace pour mieux affirmer l’invincibilité quasi inhumaine de son personnage. Car il n’y a que fort peu d’humanité en Jef Costello. Ou, pour être plus exact, l’animal domine largement en lui. Ses commanditaires le comparent à un loup, mais il y a aussi du serpent en lui : impassibilité, mouvements rapides, et surtout un regard froid qui paralyse les témoins. On l’a dit, Melville emprunte au cinéma ce qui l’intéresse, au mépris de la vérité et de la vraisemblance - jusqu’à preuve du contraire, les séances d’identification sous toise restent une spécificité américaine, d’autant qu’ici les témoins ne sont pas protégés derrière une glace sans tain.Ce qui intéresse Melville dans les films de samouraï, outre la figure du sabreur solitaire, est le rapport rituel à la mort. Et il a trouvé la matière première parfaite pour incarner cette figure : Alain Delon apporte sa froideur, son masque d’impassibilité au personnage créé par Melville, et finit par créer un archétype. Jef Costello est donc la relecture moderne par Melville de la figure du samouraï, entièrement dédié à sa mission et pourtant devenu ronin, poussé par une pulsion de mort. Car le personnage de la pianiste campé par Caty Rosier symbolise bien la Mort, qui fascine Costello, et qu’il choisit pour lui porter symboliquement le coup de grâce lors de son seppuku dans le club.
A l’origine, Costello devait rendre son dernier soupir le sourire aux lèvres - les raisons de ce changement demeurent difficile à déterminer avec certitude, il se pourrait néanmoins que ce soit le résultat d’une querelle entre Delon et Melville. Reste qu’aujourd’hui Costello s’effondre en conservant son masque de guerrier. Perfection froide du cadrage et de la photographie, abandon des personnages au profit de figures mythiques, sens de la tragédie. Les films suivants pousseront encore plus loin ces préceptes, jusqu’au point de non-retour de Un Flic. Mais tout est déjà dans Le Samouraï, une œuvre signature.
F.S.
France, 1942. Soupçonné de "pensées gaullistes", l’ingénieur Philippe Gerbier est incarcéré, puis transféré à la Gestapo, d’où il parvient à s’évader. Il se révèle être l’un des chefs de la Résistance, des hommes et des femmes que tout sépare, sauf la nécessité d’agir : Luc Jardie, le philosophe mathématicien, son frère Jean-François, tête brûlée tenté par l’aventure - chacun ignorant tout des activités de l’autre -, Mathilde, Le Masque, le Bison, et une poignée d’autres anonymes… C’est un long voyage au bout de la nuit qui commence pour ces soldats de la clandestinité, entre transmissions de renseignements et assassinats politiques, traqués par la Gestapo et la police de Vichy. Un voyage qui sera sans issue pour la plupart d’entre eux.
Tout commence par un plan fixe. La Place de l’Etoile, filmée depuis les Champs Elysées vides. Un cortège entre dans le champ. La troupe allemande menée par une section de tambours s’avance vers nous de façon inéluctable. Le cadre n’offre aucune issue, le spectateur ne peut que subir leur progression. Comme les soldats se rapprochent, la caméra fait un léger travelling descendant, comme écrasée par l’armée.

Puis l’image se fige. Fondu au noir. En un simple plan, Jean-Pierre Melville exprime toute la douleur de celui qui a vu son pays s’effondrer sous la botte brune. Ce plan est d’ailleurs celui dont le réalisateur se disait le plus fier, avec le mythique plan séquence du Doulos, entre autre pour le défi logistique qu’il représentait : répétition à 3 heures du matin sur l’Avenue d’Iéna, puis tournage à 6 heures, sonorisé par des vrais bruits de bottes allemandes.
Défi également à cause d’une tradition empêchant encore la présence d’acteurs portant l’uniforme allemand sur l’avenue - Vincente Minnelli avait dû y renoncer pour Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse. Ce problème n’était d’ailleurs pas une nouveauté pour Melville, qui avait dû "voler" les plans de Howard Vernon marchant en uniforme dans les rues de Paris, deux ans seulement après la fin de l’occupation, dans Le Silence de la Mer. Mais il ne faudrait pas voir dans ce plan un simple caprice de réalisateur attiré par la démesure, car mieux que tout autre il donne le ton du film, et l'on ne regrettera pas que Melville ait in-extremis décidé de le monter en ouverture - à l’origine, il concluait l’œuvre.
A la sortie du film, Melville reçut de nombreux reproches. Certains l’accusèrent même d’avoir fait une œuvre dogmatique gaulliste. D’autres rirent lors de l’apparition du Général De Gaulle. Pourtant, L’Armée des Ombres n’a rien d’une œuvre militante : aucun parti ni section n’est cité, le seul communiste déclaré est le jeune électricien pour lequel Gerbier se prend d’affection, tout en le qualifiant d’« enfant perdu ». Si d’autres ont reproché à Melville d’avoir appliqué ses codes du film de gangsters à L’Armée des Ombres, c’est pourtant l’originalité de ce traitement qui donne sa force à la représentation de la Résistance. Les soldats de L’Armée des Ombres obéissent à des codes indicibles et immuables, ils n’agissent pas par idéologie mais parce qu’ils doivent le faire.
De fait, leur comportement s’apparente par bien des aspects à celui des bas-fonds : des silences, des regards - parmi d’autres, le dernier lancé par Mathilde, terriblement ambigu -,… et la conscience de ce qui doit être fait. Car Melville n’héroïse jamais ses personnages, et montre crûment les aspects les plus durs de leur entreprise - et la séquence la moins marquante n’est pas l’exécution du jeune traître, bruitée uniquement par ses cris d’agonie étouffés par le bâillon. De lui, nous ne saurons jamais rien, ni de son passé, ni des motifs de sa trahison. Nous savons seulement que cela devait être fait. Et nul n’en tire ni gloire ni fierté. Seul le personnage de Jean-François échappe quelque peu à ce schéma : il agit moins par devoir que par attirance pour l’aventure, renforcée par sa certitude d’avoir « la baraka ». Certitude qui le poussera à accomplir un acte héroïque, et d’apparence inutile. Son sacrifice et son martyr permettront néanmoins d’abréger les souffrances de Félix.
La froideur de la description des agissements des Résistants est encore accentuée par le dispositif de la mise en scène, presque théâtrale : on note en effet de nombreux plans fixes, où les personnages entrent et sortent du cadre immobile. Ces séquences renforcent encore les rares travellings du film, qui prennent une force notable, notamment celui sur Gerbier s’échappant de la Gestapo, et plus encore celui sur le corps de Mathilde. Jean-Pierre Grumbach, qui prit le nom de Melville en entrant dans la Résistance, raconte que lorsqu’il a projeté le film à Joseph Kessel, celui-ci s’est mis à sangloter en découvrant les phrases qui annoncent le destin tragique des personnages survivants, phrases qui n’étaient pas dans le scénario à l’origine. Et la sécheresse de ces sentences conclut le film sur une note d’émotion inattendue laissant le spectateur bouleversé par le sacrifice de ses hommes et femmes. L’Armée des Ombres, une contribution essentielle au devoir de Mémoire, et l’un des plus beaux films que nous ait offert le cinéma français.
F.S.
Corey (Alain Delon) sort de la centrale de Marseille après cinq années de prison. Alors qu’il regagne Paris et fait une halte dans un restaurant, Vauchel (Gian Maria Volonte), un truand en cavale, se cache dans son coffre. Corey, qui a repéré l’homme, passe tout de même les barrages de police. Une fois à l’abri, il se présente à lui et immédiatement un fort lien d’amitié et de confiance se crée entre eux. Ils travaillent ensemble sur le casse d'une bijouterie, bientôt rejoints par Jansen (Yves Montand), un ancien flic devenu criminel. Jansen est un tireur hors pair, mais, alcoolique, il doit pour jouer son rôle dans le cambriolage parvenir à se sevrer. Tandis que les trois hommes se préparent, le commissaire Mattei (Bourvil), qui convoyait Vauchel lors de son évasion, resserre lentement son filet autour d'eux...

Quinze années séparent Le Cercle rouge et Bob le flambeur, le premier film criminel de Melville. Le fossé entre les deux œuvres, et pas seulement en terme de style et de mise en scène, permet de se rendre compte la façon dont Melville a perçu la transformation de la société française entre les années 50 et 70 et l’a racontée à travers le cinéma policier. Les tripots enfumés ont cédé la place à des architectures froides et glacées, et la gouaille des truands s’est transformée en mutisme. Les flics d’autrefois attrapaient les criminels en manipulant les indics, en jouant sur les divisions de la pègre, en utilisant l’appétit de pouvoir ou la peur de certains, bref, en étant en contact avec le milieu.

Ceux de 1970 utilisent des micros et des caméras de surveillance, piégeant leur cible de loin, cachés derrière leurs moniteurs et leurs écouteurs. Melville sent qu’une déshumanisation de la société est à l’oeuvre, il a le sentiment que les liens entre les hommes s’étiolent et que l’individu tend à se déliter dans ce monde moderne où tout est désincarné, marchandisé, mécanisé. Tout cela, Melville ne l’explicite, mais le raconte en mettant en scène ses derniers films policiers comme des histoires de fantômes.
Dans Le Cercle rouge, il filme les villes et la campagne comme des territoires désaffectés. Ce ne sont plus que des étendues glacées et désertiques plongées dans la brume du petit matin, des paysages silencieux recouverts par la bruine. Tout l'espace devient ainsi fantomatique, irréel, les éclairages bleutés et les architectures métalliques participant à la création de cet univers froid comme la mort. De film en film, Melville tend aussi à transformer ses personnages en silhouettes. Par goût pour l’iconisation bien sûr, mais aussi parce qu’en accentuant leur hiératisme, en figeant leurs visages et leurs gestes, il les pare du masque de la mort. C’est ainsi que les héros traversent le film comme des fantômes arpentant le territoire des morts.
O.B.
Un Flic (1972)
Le Cercle rouge, formidable polar silencieux et austère marqué par la fatalité et la tragédie, est une forme d'accomplissement dans l'œuvre de Melville. C'est une œuvre fondamentale qui reçoit un énorme succès public. Melville signe le film populaire parfait, à la fois jeu de piste cérébral et grand moment de plaisir cinématographique. Le succès est tel que Melville s'en trouve embarrassé, ne sachant plus quelle suite il peut donner à sa carrière. Il vient de mettre en scène un long chant funèbre annonçant qu'il ne peut plus tourner les mêmes films qu'avant, et il reçoit un plébiscite sans précédent. Sa réponse sera finalement Un flic.
Le dernier film de Jean-Pierre Melville fait souvent figure de vilain petit canard de sa filmographie. Trop abstrait, désincarné, incompréhensible et ennuyeux, voici quelques uns des reproches qui lui sont faits fréquemment. Si ces qualificatifs ne sont pas forcément toujours usurpés, il faut pourtant passer outre pour en découvrir les beautés : après Le Samouraï et Le Cercle Rouge, Melville pousse encore plus loin sa volonté d’abstraction et se regarde faire du cinéma. Les personnages ne sont plus que des silhouettes, des symboles, les décors se vident, la trame n’est qu’un prétexte. En témoigne la somptueuse séquence de braquage qui ouvre le film dans une station balnéaire fantôme noyée dans la brume. Un film étrange, désagréable et mal-aimé, pourtant à redécouvrir.La mauvaise réception de ce film radical et étrange va détruire intérieurement cet homme profondément anxieux et stressé. Il disparaît peu après la sortie du film, succombant à une rupture d'anévrisme due à l'angoisse et la tension. C'était en 1973, Melville avait 56 ans et sa disparition coïncidait avec celle du mythe policier dont il demeure l'un de ses plus grands représentants.
F.S.ARTICLE écrit par Par
- le 21 janvier 2013
Sources :
superbe blog...http://www.dvdclassik.com/article/melville-a-travers-ses-films
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Dona Rodrigue