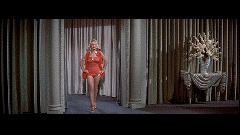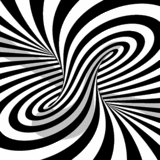-
Par Dona Rodrigue le 13 Novembre 2012 à 23:39

Federico Fellini

En 1960, une statue du Christ traverse le ciel romain, passe au-dessus d’antiques aqueducs, portée par un hélicoptère : c’est la scène d’ouverture de La Dolce Vita. Palme d’or à Cannes, le film réinvente le cinéma et marque à jamais les esprits comme le vocabulaire, du titre lui-même à nos paparazzi contemporains, qui ont hérité leur nom de Paparazzo, le photographe du film, joué par Walter Santesso.
Qui est Fellini ?
Un « grand menteur », un « cantastorie » (une sorte de chanteur ambulant), aimait-il dire. Un « demi-dieu », créateur de mondes aussi réels qu’oniriques. Un magicien de l’image. Le Maestro. Mais voilà, Fellini est surtout aujourd’hui une grande icône du passé, comme cette immense tête antique trimballée dans les rues du Satyricon : le temps semble avoir passé sur ses films, dont on fait des monuments, et que l’on fige dans des clichés qui, pour avoir leur part de vérité, n’épuisent pas la richesse et la vie si intense de ses œuvres. Retour sur un cinéaste adulé, mais peut-être aussi mal-aimé.
Plan de l’article :
I. Partir du néoréalisme : en naître, et le quitter…, par Vincent AvenelII. Fellini et le monde du spectacle, par Ariane PrunetIII. Roma-Amor- à mort…, par Anne-Violaine HouckeIV. « Femmes, je vous aime… », par Anne-Violaine HouckeV. Intemporel Fellini ? La critique… visionnaire d’une époque, par Anne-Violaine HouckeVI. Une certaine idée de la musique dans l’œuvre de Fellini, par Romain EstorcVII. Dernier appel… Les voyageurs sont priés d’embarquer, par Anne-Violaine HouckeEn partenariat avec la rétrospective de la Cinémathèque :
Coffret DVD "Fellini au travail", par Anne-Violaine HouckeExposition Fellini, la grande parade, par Anne-Violaine HouckeInterview Sam Stourdzé, par Anne-Violaine HouckeII. Fellini et le monde du spectacle
De son enfance telle qu’il l’a représentée dans bon nombre de ses films, Fellini semble avoir gardé les souvenirs marquants de ses premières expériences de spectateur, expériences qu’il évoquera ensuite à plusieurs reprises au cours de sa filmographie, dans Les Vitelloni, Amarcord, Fellini Roma ou encore Les Feux du music-hall. Occupant par ailleurs une place prépondérante dans le cinéma du réalisateur, le monde du spectacle constitue, littéralement ou métaphoriquement, l’un des éléments centraux et incontournables de l’univers fellinien.
L’enfance de l’art : vestiges d’un monde évanescent
Premiers contacts avec le cinéma : c’est à l’âge de 7 ans, dans une petite salle de Rimini, que le jeune Federico voit son premier film sur les genoux de son père. À la même époque, alors qu’il est pensionnaire dans un collège de prêtres à Fano, le futur cinéaste parvient par un petit matin à échapper à sa geôle cléricale, puis erre dans les rues pour finalement atteindre une petite place sur laquelle une troupe de cirque a élu domicile. Il passe alors la journée avec des saltimbanques qui tolèreront sa présence sans lui poser la moindre question… De cette première incursion dans un univers qui ne cessera dès lors de l’inspirer, Fellini déclarera en 1979 : « Le cirque m’est inné. Il s’est manifesté en moi, tout de suite, une traumatisante et totale adhésion à ce vacarme, ces musiques, ces monstrueuses apparitions, ce risque mortel. J’ai regardé le chapiteau comme une usine de prodiges, un lieu où s’accomplissaient des choses irréalisables pour la majeure partie des hommes. »

En 1939, la revue Cinemagazino confie à Fellini quelques enquêtes à faire sur les célébrités du music-hall. C’est l’occasion pour lui de plonger dans un monde auquel la scène de Rimini l’avait familiarisé enfant, et qu’il portera à l’écran en 1950 dans Les Feux du music-hall – généralement considéré comme sa première œuvre de cinéma et co-réalisé avec Alberto Lattuada. Le film, qui raconte l’histoire d’une troupe de comédiens et de danseurs itinérants, décrit avec une précision grinçante les mécanismes d’un univers qui ne va pas sans rappeler ceux d’un show-business nauséabond, show-business que le cinéaste évoquera par la suite avec Ginger et Fred et même, dans une moindre mesure, avec La Dolce Vita, Tobby Dammit ou même Huit et demi.
Fasciné dès son plus jeune âge et jusqu’à la fin de sa vie par le spectacle et par les formes les plus étranges et fantasmatiques de celui-ci, Fellini ne cessera donc, tout au long de sa carrière, de revenir aux sources premières de son inspiration. Car si l’enfance tient une part importante dans la plupart de ses films, et si son évocation exprime quelque chose d’essentiel d’une origine des mondes portés à l’image, c’est en tant que cette enfance investit une part du présent, notamment à travers les expériences et les inserts spectaculaires. « Je pense que nous avons tous » remarque ainsi le cinéaste, « dans notre enfance, un rapport estompé, émotionnel, rêvé avec la réalité ; tout est fantastique pour l’enfant, parce que inconnu, jamais vu, jamais expérimenté, le monde se présente à ses yeux comme (…) un gigantesque spectacle, gratuit et merveilleux. »

De sorte que le visage à la fois incrédule, vaguement inquiet et néanmoins émerveillé que l’on devine chez le futur cinéaste rencontrant pour la première fois des saltimbanques, c’est celui que l’on verra plus tard chez l’enfantine Gelsomina de La Strada, lorsque écartant les pans d’un chapiteau elle semble découvrir un monde neuf dans un mouvement quasi initiatique ; c’est aussi l’empressement excité du petit garçon qui ouvre sa fenêtre au début des Clowns et se rend compte qu’un cirque a élu domicile sur la place attenante à sa maison ;
c’est enfin le visage baigné de larmes d’Anita Ekberg se redécouvrant jeune et belle à l’écran dans Intervista, lorsqu’en un tour de magie malicieux Marcello Mastroianni fait apparaître sur un drap tendu une scène mythique de La Dolce Vita, renouant ainsi avec des dispositifs primitifs du cinéma pour souligner la temporalité particulière qui est celle de l’image. Faite de présent et de passé, de vivants et de morts, de devenir et de pétrification, cette temporalité devient alors, par extension, celle du monde du spectacle dans son entier.
Car à l’instar des clowns auxquels Fellini rend un vibrant hommage en 1970 dans un film éponyme, le spectacle tel qu’il habite et hante l’image du cinéaste italien apparaît souvent comme le vestige d’un monde disparu ou en voie de disparition, s’évanouissant sous l’œil du spectateur, aussi fragile et évanescent que les fresques antiques qui, dans Fellini Roma, s’effacent d’un simple courant d’air.
Le film gigogne : Fellini et le monde du cinéma
Outre le spectacle vivant qui trouve donc une large représentation au sein de son œuvre, Fellini a porté à l’image, à plusieurs reprises, le monde du cinéma, évoquant tour à tour la fabrication des films – dans Intervista, Fellini Roma ou Les Clowns –, les incongruités du star-system – dans Toby Dammit et la Dolce Vita –, ou encore les angoisses d’un réalisateur parfois en panne d’inspiration – dans Huit et demi. Apposant à la narration les images du film « en train de se faire », le cinéaste en vint ainsi, à plusieurs reprises, à mettre en abyme son geste créateur : dans Fellini Roma, Intervista et Les Clowns, Fellini joue en effet son propre rôle, et se « raconte » en train de filmer.
Inversant donc ce qui serait de l’ordre d’un dispositif traditionnel de la scène, donnant à voir dans un geste ludique ce qui se passe derrière la caméra plutôt que ce qui arrive devant elle, Fellini franchit les lignes qui conventionnellement séparent le spectateur du spectacle, et le spectacle de son concepteur.
D’un côté, dans Amarcord, les nombreuses adresses caméra brisent le quatrième mur traditionnel de la scène théâtrale, assurant une certaine porosité du réel face aux encarts spectaculaires ; de l’autre, dans Intervista, Fellini portant à l’image une interview choisit de filmer la caméra plutôt que son sujet, l’ « interviewé » (lui-même), n’étant signalé que par une voix off. La frontière entre le spectacle et le monde « réel » que ce spectacle est censé représenter se fait alors de plus en plus ténue, tout comme la limite incertaine qui sépare, chez le cinéaste, un réel supposé rationnel de toutes les rêveries fantasmatiques.
Le monde du spectacle et le spectacle du monde :
la misère à l’écran
De ses jeunes années passées au contact de troupes de music hall, et de ses premières expériences de cirque et de cinéma, il semble que Fellini ait retiré le désir de décrire l’univers du spectacle avec un précision quasiment documentaire. Résulte de cela un véritable oxymore thématique : portant à l’image les artisans des « machines à rêve » que sont l’écran et la scène, le réalisateur en vient souvent à dessiner un monde de presque-ratés et de miséreux, d’artistes victimes des systèmes qu’ils contribuent à construire. Irréductiblement solitaire – à l’instar de Zampano ou des stars isolées que sont Toby Dammit et le Guido de Huit et demi –, souvent traité – quoique de manière consentante – comme un animal de foire, l’artiste fellinien semble en effet jeté en pâture à un public carnassier dans un engrenage qui ne l’est pas moins, forcé de continuer à œuvrer quoiqu’il lui en coûte, interdit de toute échappée salvatrice comme le seront explicitement Ginger et Fred, enfermés dans les locaux terrifiants d’une – déjà très berlusconienne – chaîne de télévision italienne.

Plaque commémorative sur la façade de la maison rue Margutta à Rome où habitèrent Federico Fellini et Giulietta Masina.
Roma, via Margutta: Memoria di Federico Fellini e Giulietta Masina sulla casa in cui abitarono
Des comédiens hués et chahutés de Fellini Roma, forcés de poursuivre leur numéro dans un cabaret miteux du Barafonda malgré les réactions pour le moins hostiles des spectateurs, à l’équilibriste de La Strada, dont le moindre vacillement provoque d’obscènes applaudissements au sein de la foule qu’il surplombe, l’artiste fellinien semble parfois vivre de la fascination morbide d’un public de voyeurs, envoûté par les multiples dangers encourus par Zampano brisant ses chaînes au péril de sa vie, excité jusqu’à l’hystérie à la vue de deux malheureux enfants prétendant voir la vierge sous une pluie battante (La Dolce Vita).

Comparant enfin explicitement les clowns
– toujours dans le film qu’il leur a consacré
– aux misérables du monde
– fous, invalides etc…
– Fellini fait du spectacle, et en particulier de l’univers du cirque, l’écho fantasmatique et inquiétant d’un monde supposé rationnel, dans un rapport de métaphore et de métonymie qui ne va pas sans brouiller les frontières du réel.
Donnant à voir le monde du spectacle, le cinéaste en vient ainsi à dessiner le spectacle du monde, que ce spectacle soit organisé – la procession religieuse dans La Strada, les défilés fascistes dans Amarcord – ou purement fortuits – comme c’est le cas, toujours dans Amarcord, lorsque l’un des adolescents attire l’attention des villageois en frimant dangereusement au volant d’un bolide.
L’illusion rédemptrice :
mise au jour d’un monde palimpseste
Toutefois, si d’un côté Fellini s’attache à filmer le monde du spectacle et les artistes qui le peuplent avec une rigueur et une précision quasiment documentaire – et parfois sous la forme d’une satire grinçante comme c’est le cas dans Le Cheikh Blanc ou dans Huit et demi – il présente par ailleurs les intrusions du spectaculaire dans le réel comme un échappatoire désirable, comme le moyen pour les personnages – et a fortiori pour les artistes – de fuir la misère et l’étouffement, de trouver un apaisement fugace et néanmoins salvateur.
C’est ce dont témoigne « Ginger » lorsque se retrouvant seule, en pleine nuit, sur un parking glauque et totalement déserté, elle se prend à fantasmer une scène de cabaret ; tout comme Gelsomina trouvant un apaisement dans la musique ; les musiciens de Répétition d’orchestre n’ayant plus d’autre alternative, après un tremblement de terre, que de reprendre leur travail ; ou encore les « inutiles » des Vitelloni que le spectacle transporte, l’espace de quelques heures, à bonne distance de leur ennui.
Si le spectacle fellinien investit donc la narration, dans un mouvement qui se fera de plus en plus diffus et dispersé au fil du temps et de la filmographie du cinéaste, c’est en tant que le spectaculaire désigne enfin et surtout un monde façonné d’illusions et de rêves, d’une duplicité essentielle qui ferait du sensible immédiat le comble du mensonge. « Tu vois, un paysage », faisait ainsi remarquer Fellini à Dominique Delouche, « par exemple comme celui que nous avons devant les yeux. Il me semble que ce paysage a plusieurs aspects de réalité. Il y a son aspect sensible et superficiel, et il y a aussi son aspect caché, mystérieux et spectral ; et ce qui m’intéresse, moi, c’est de montrer les choses qui sont derrière les choses… »
Tel le réel sensible qui peu à peu naît à l’image dans Répétition d’orchestre, facette partielle du monde qui se superposerait à une autre – les meubles apparaissent ainsi progressivement, en surimpression, dans la salle vide – l’univers du spectacle exprime, avec le rêve qu’il porte en lui, les aspects insaisissables d’un monde palimpseste, de ce qui dans ce monde échappe au sensible immédiat et à la représentation spontanée, dont la quête justifie par ailleurs pleinement le recours à un artifice caractéristique du cinéma fellinien. Artifice du studio, auquel le cinéaste rend hommage dans Intervista et dont il a fait sa marque de fabrique – c’est ainsi que dans Fellini Roma, le réalisateur désirant reproduire une « impression » de l’arrivée dans Rome aussi authentique que possible choisit de reconstituer à Cinecittà une gigantesque portion d’autoroute

– ; artifice également du médium cinématographique lui-même, dont les diverses occurrences du « cinéma dans le cinéma » rendent compte, et qui trouve une expression particulièrement significative dans Répétition d’orchestre : prétendant dans la diégèse du film réaliser un documentaire, usant et abusant par ailleurs de tous les procédés caractéristiques du cinéma (effets de montages, mise en scène proprement « spectaculaire » etc…), Fellini ne fait alors que souligner les procédés artificiels qui sont les siens et qu’il désigne, au sein de son dispositif, comme le moyen le plus sûr de parvenir à juste une représentation du monde.
Comble de l’artifice, le rêve fellinien est aussi sans nul doute, pour le réalisateur, le pan indispensable du monde porté à l’image, représenté par le biais d’un système de codes qui, comme sur scène, échappent à une certaine contingence : « Le rêve au cinéma » remarque ainsi Patrice Lajus dans Fellini ou la vision partagée, « n’est jamais qu’un faux puisqu’il est consciemment élaboré à partir de matériaux empruntés au monde concret ; et la réalité enclose dans le cadre des images acquiert une part de l’irréalité des rêves. »
À l’instar donc du monde des années 1980 – porté à l’écran dans Ginger et Fred – qui subit une inquiétante infiltration de l’imagerie télévisuelle, l’univers fellinien semble souvent procéder d’un mouvement par lequel le spectacle accouche d’un ensemble d’éléments oniriques qui, se mêlant au réel, finissent par se confondre avec lui. De sorte que si La Cité des femmes est peut-être la seule œuvre du cinéaste à être explicitement développée comme le rêve de son protagoniste, le procédé que Fellini met alors en place semble représentatif de l’ensemble de sa filmographie.
« En livrant mes souvenirs au public », confessait ainsi le cinéaste, « je les ai effacés, et au surplus je ne sais plus distinguer ce qui a eu lieu pour de bon et ce que j’ai inventé. Au souvenir vrai se superpose le souvenir des toiles de fond, de la mer en plastique et les personnages de mon adolescence à Rimini sont comme repoussés à grands coups de coude par les comédiens et les figurants qui les ont représentés dans les reconstructions scénographiques de mes films. »…
Au terme du spectacle, qu’il s’agisse d’un numéro de cirque, d’un moment de music hall ou de deux heures passées au creux d’une salle obscure, le spectateur et le personnage semblent forcés d’admettre, à l’unisson de la frêle héroïne du Cheikh blanc, que « la vraie vie est dans le rêve ».
« Le clown est un miroir dans lequel l’homme voit son image grotesque déformée et comique ». Fou de clowns, d’équilibristes et de saltimbanques en tous genres, Fellini ne cesse de se jouer de la nécessaire distorsion de l’image – distorsion que figure, au sens propre, l’écran de cinéma déformé de Fellini Roma qui, transcrivant les dernières nouvelles du fascisme, désigne métaphoriquement les utilisations paroxystiques des pouvoirs illusoires et envoûtants de la représentation.
Il donne à voir du même coup un monde fait d’exubérance, de rêves inquiétants et de fantasmes surannés. Baroque, le cinéma de Fellini traduit les incertitudes et les déchirements de son (ou de ses) époque(s). Dans un monde fait d’extrêmes, en perte de repères, c’est avec un sentiment aigu et grandissant de l’absurdité des choses que le cinéaste italien dessine la zone d’incertitude où le spectaculaire trouve à s’épanouir aux limites incertaines et poreuses d’un réel et d’un imaginaire qui le plus souvent co-existent dans une relative harmonie.
Et si l’on en croit le réalisateur lui-même, qui, à la toute fin d’Intervista cherche désespérément comment terminer son film sur une note d’espoir et ne trouve pour cela rien de mieux qu’un « clap » marquant le début ou la fin d’une prise, il se pourrait bien que cet imaginaire, le spectacle qui l’instaure et a fortiori le cinéma lui-même constituent une chance unique d’apaisement.
III. Roma-Amor- à mort…
À la Libération, Fellini accompagne Rossellini sur le tournage de Païsa : la traversée du pays est une révélation. Fellini découvre l’Italie, ses souffrances et ses joies, sa richesse humaine, en même temps qu’il comprend que le cinéma sera pour lui le moyen d’exprimer tout cela. C’est pour l’épisode florentin de Païsa qu’il aura tourné son premier plan. Mais c’est Rome qui sera sa terre d’élection cinématographique. Rome, la Ville éternelle dont parle Freud dans Malaise dans la civilisation, en y cherchant, dans la coexistence rêvée de toutes les strates temporelles, une possible image de l’inconscient. Rome est l’Image-source de l’univers fellinien, sa scène originelle, pourrait-on dire pour filer ensemble la métaphore freudienne et l’allusion cinématographique. Rome, c’est à la fois ces ruines qui exposent le temps et sa mémoire, la Louve capitoline, mère et prostituée, et Cinecittà. Le lieu des origines, donc…
Esthétique du fragment et de la fresque
« Le monde antique n’a peut-être jamais existé, mais cela ne fait aucun doute que nous en avons rêvé [1] ». Le Satyricon sera donc « le documentaire d’un rêve » [2]. Aux racines de ce rêve, il y a le Satyricon de Pétrone, auteur latin, dont on sait peu de choses, sinon qu’il fut peut-être ce Petronius Arbiter, favori de Néron qui finit par susciter l’ire impériale et fut acculé au suicide. Voilà qui n’était pas pour déplaire à un cinéaste dont le plus ancien souvenir cinématographique, tant de fois raconté et mis en scène, est Maciste en enfer (Guido Brignone, 1926). La plongée dans l’antiquité est donc conçue comme un retour à l’origine – origines de Rome, origines du moi fellinien, origines du cinéma lui-même. Ce n’est ni la première ni la dernière fois que Fellini se confronte à l’« adaptation » d’une œuvre littéraire : il y avait eu, un an plus tôt, Toby Dammit, inspiré d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe, « Never Bet the Devil Your Head » (« Ne pariez jamais votre tête au diable »).
Il y aura ensuite Casanova, d’après les Mémoires de Giacomo Casanova, et La Voce della Luna, poème filmique bâti sur Le Poème des lunatiques d’Ermanno Cavazzoni. Sans oublier Le Voyage de G. Mastorna, issu d’une collaboration manquée avec Dino Buzzatti, film-obsession jamais tourné de Fellini [4]. Dans chacun de ces films, l’œuvre-source est un prétexte à l’imagination : un texte premier qui la met en mouvement et la nourrit, sans jamais la contraindre. Et justement, si le roman de Pétrone fascine tant Fellini, c’est pour tout ce qu’il ne dit pas, tout ce que le passage du temps lui a arraché, et qu’il faut désormais deviner. L’éclatement du récit, initié avec La Dolce Vita, s’autorise ici de la nature fragmentaire de l’œuvre de départ. Loin de chercher à colmater les brèches, le cinéaste va les agrandir, au risque de l’hermétisme, au risque de faire naître un film mal-aimé. Mal compris, peut-être : car il y va de l’imagination du spectateur autant que celle de l’auteur.
L’architecture des films felliniens à partir de La Dolce Vita – des tableaux animés, des scènes fondamentales, des fragments de fresques étrangement dilatés et bizarrement mouvementés – requiert du spectateur qu’il sache lâcher prise pour se laisser emporter par l’apparente incohérence des visions projetées sous ses yeux : mais Fellini a le pouvoir extraordinaire de rendre cet abandon actif, de demander à notre imagination de compléter le tableau.
Voici comment Fellini envisageait la réalisation du Satyricon : « Tenter de recomposer un monde inconnu, à travers une structure figurative et narrative de nature quasi archéologique.
Faire comme fait, justement, l’archéologue quand, avec des tessons, ou avec des ruines, il reconstruit, non pas une amphore, ou un temple, mais quelque chose qui fasse allusion à une amphore, à un temple : et ce quelque chose est plus suggestif que la réalité originaire, par cette part d’indéfini et d’irrésolu, qui en accroît la fascination, en postulant la collaboration du spectateur. » Le Satyricon est explicitement conçu comme une fresque que la magie cinématographique animerait, le temps d’un instant : à la fin du film, un fondu-enchaîné ramène les personnages à l’immobilité, simples dessins figés dans les ruines d’une fresque exhumée sur une plage inconnue.
Rome, ruines d’un rêve, rêve de ruines : l’invention fellinienne
Rome n’est-elle pas par excellence la ville où le temps montre son pouvoir d’érosion ? Les ruines des civilisations précédentes exposent le passage du temps et son pouvoir de destruction : elles sont un memento mori visible, et omniprésent dans presque tous les films de Fellini. L’univers baroque du cinéaste fait résonner les propos de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout n’est que vanité ». La nostalgie fellinienne est devenue un lieu commun de l’analyse de ses films, et le premier plan de Fellini Roma, libre divagation à partir de souvenirs d’enfance, figure une sorte de ruine indiquant : « Roma ». La messe est dite, semble-t-il : l’enfance partage avec les civilisations passées de n’être plus, et les souvenirs en sont les ruines.
Mais justement, l’ambivalence de la ruine est bien de signifier l’absence par sa présence. Elle est comme un symptôme anachronique qui vient déchirer le présent. Elle fait signe vers un passé qui n’est plus, définitivement : « l’antiquité n’a peut-être jamais existé ». Mais elle fait signe, justement : « nous en avons rêvé ». Le passé laisse dans le présent des matériaux où l’on peut puiser pour la construction d’œuvres futures. On connaît la scène célèbre de l’effacement des fresques antiques lors du creusement du métro dans Roma, sublime enregistrement de l’éphémère, fascinante représentation d’un monde qui nous échappe. Mais on oublie que le cinéaste avait aussi imaginé la scène « inverse » : dans le Bloc-Notes d’un cinéaste, « documentaire » réalisé pour la télévision américaine en 1969, Fellini descend dans le métro romain à la recherche d’inspiration pour le Satyricon : les quais se peuplent alors de figures antiques sorties tout droit de ce que les traces de l’antiquité dans le présent ont fait naître dans l’imagination du cinéaste.
Réduire Amarcord ou Fellini-Roma à des films autobiographiques étaient pour Fellini l’une des pires injures qu’on puisse lui faire. L’on pourrait dire de l’enfance ce que Fellini disait de l’antiquité : qu’elle n’a « peut-être jamais existé ». Le passé n’est plus, et non seulement cette absence insinue le doute sur son existence même, mais elle rend vaine, inanimée, toute « reconstitution ». Mais les souvenirs sont comme les ruines des civilisations passées : des traces, des symptômes dont l’énergie latente informe nos rêves, des matériaux pour des constructions présentes et futures. Il est aussi vain de reprocher au Satyricon de n’être pas une reconstitution fidèle du monde de Néron que de réduire Amarcord ou Fellini-Roma à l’autobiographie fellinienne.
Fellini est peut-être l’un des plus grands « inventeurs » qui soit, au sens où l’invention, c’est aussi bien la mise au jours des ruines en archéologie que le processus imaginatif à l’origine de toute création. Si Heinrich Schliemann est l’inventeur de Troie, Fellini est l’inventeur de lui-même.
« Le rêve fou, improbable, éphémère, du cinéma »
Au fond, la parenté si étroite que Fellini ressent entre Rome et le cinéma, ne trouve-t-elle pas sa source dans l’identité qu’il ressent entre la vie d’une civilisation et la vie de ses propres films ? Le titre de Fellini Roma s’inscrit, dès le premier plan, sur une ruine. Si le Bloc-Notes d’un cinéaste montre Fellini en repérages dans les ruines du forum pour le Satyricon, il s’ouvre significativement sur les ruines monumentales des décors d’un film de Fellini, le Voyage de G. Mastorna.
Le film, et l’image cinématographique elle-même, sont le lieu de l’éphémère, pris sans cesse entre le moment de leur apparition et celui de leur disparition. Le pouvoir du cinéma est aussi sa faiblesse intime : il est le lieu d’une évocation – au sens étymologique, et le cinéaste est comme l’historien dont parle Walter Benjamin, « maître d’un souvenir tel qu’il brille à l’instant d’un péril. »
IV. « Femmes, je vous aime… »
Fellini, Romulus moderne
Fellini Roma se termine sur les rues de Rome, désertes et plongées dans la nuit. Anna Magnani rentre chez elle : c’est sur son visage que Fellini souhaite conclure le poème filmique qu’il vient de dédier à la Ville éternelle. Ce sera d’ailleurs la dernière apparition cinématographique de la diva... Elle pourrait être « le symbole de la ville », dit-il en voix off : « une Rome louve et vestale, aristocrate et clocharde, un sombre pitre ». Anna Magnani, incarnation du cinéma lui-même, marqué à jamais par le cri tragique de l’actrice à la fin de Mamma Roma. C’est sans nul doute ce film de Pasolini que Fellini inscrire en creux dans son propre film, si tant est que Anna Magnani, prostituée et mère sublime, y était déjà à la fois Rome et le cinéma tout entiers. Et puis, Fellini n’avait-il pas mis la Magnani enceinte, dans son rôle de saint Joseph dans Le Miracle (Rossellini, 1948) ? Aux origines de Rome, il y a un mythe, celui de Romulus et Remus, nourris par une louve, dont le nom latin, lupa, signifie aussi « prostituée »…
Fellini le sait très bien, qui joue de cette ambivalence dans la scène de projections de diapositives aux écoliers de Roma : la série commence sur la célèbre Louve capitoline, pour se clore « par mégarde » sur l’image des fesses rebondies d’une prostituée… Entre les deux avaient défilé tous les monuments symboliques de Rome, l’Arc de Constantin, l’Autel de la Patrie, Saint-Pierre.
L’affiche américaine du film reproduit la louve du Capitole, mais remplace les jumeaux mythiques par les personnages felliniens : la femme, mère et prostituée à la fois, y est donc aussi le cinéma, l’origine des créations felliniennes, et lui-même… un nouveau Romulus, fondateur de Rome.
L’assimilation entre Rome, le cinéma et la femme, récurrente, ne sera jamais poussé si loin que dans La Cité des femmes, où une salle de cinéma devient soudain un gigantesque lit où se masturbent des gosses absorbés par l’écran de projection.

La Saraghina, la Volpina, la Gradisca… La ritournelle des fantasmes
À côté de Giulietta Masina, petit clown burlesque et pathétique dans La Strada ou prostituée désarmante dans Les Nuits de Cabiria, figure angélique, enfantine, âme sœur au grand cœur, la filmographie fellinienne compose un véritable défilé de figures féminines fantasmées, nymphomanes aux fessiers gigantesques et aux poitrines débordantes, qui tiennent tout autant de la mamma italienne que de la chienne en chaleur. De la Saraghina dans 8 ½ à la Volpina d’Amarcord, de la buraliste d’Amarcord à la fermière de La Cité des femmes, des Messalines antiques à la Gradisca, Fellini crée tout un monde de figures qui renvoient les unes aux autres et prennent leur source dans le souvenir et l’imagination. Mastroianni, bien souvent l’alter ego de Fellini à l’écran, marionnette où le Maestro se projette, se perd avec autant de délectation que d’effroi dans le monde merveilleux de La Cité des femmes qui, comme dans les contes, peut se transformer en cauchemar.
Le procès de misogynie intenté au film n’a pourtant pas lieu d’être, et le film, mal reçu, fut certainement aussi mal compris. Et quand Mastroianni-Spanoràz découvre sous son lit le toboggan d’une sorte de Luna Park fantasmatique, c’est toute la théorie des fantasmes felliniens qui se met à défiler sous nos yeux dans la descente vertigineuse qui s’ensuit. L’inconscient, comme un gigantesque parc d’… « attractions ».
Il suffit de feuilleter l’inépuisable Livre de mes rêves pour plonger dans l’intimité… des nuits felliniennes : de ses rêves, de ses figures rêvées, donc. Au début des années soixante, le psychanalyste jungien Ernst Bernhard conseille au cinéaste de dessiner ses rêves : trente ans de dessins commentés qui viennent d’être publiés et qui regardent les films comme en un miroir.
Du latin lover à Casanova
C’est aussi à leurs manques et à leurs faiblesses que les femmes renvoient les hommes chez Fellini. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : l’Eglise, le fascisme, la famille ont agi comme autant de mères castratrices, et les hommes ne sont après tout que d’éternels adolescents, comme ceux d’Amarcord justement, qui viennent se noyer dans le giron voluptueux de la buraliste pour … téter. Anita Ekberg, pin-up blonde et bombe sexuelle de La Dolce Vita, se retrouve logiquement, dans Les Tentations du docteur Antonio, égérie d’une campagne publicitaire pour une marque de lait. Alors nécessairement, le latin-lover de La Dolce Vita, Marcello Mastroianni, ne peut que se retrouver aussi un peu en Casanova, en qui il voit l’explorateur du continent Femme, mais qui n’est peut-être, au fond, que le produit d’une culture catholique qui l’a maintenu dans une vision adolescente de la femme. Et qui le condamne à enchaîner les conquêtes, à la recherche d’une image idéale. Casanova, magistralement interprété par Donald Sutherland, fait l’objet de toute la détestation d’un Fellini, qui pourtant avoue se reconnaître en lui… L’aventurier de la conquête féminine n’est qu’un « mâle italien dans sa version la plus triste, un lâche, un fasciste ».
D’ailleurs, poursuit le cinéaste, « qu’est-ce que le fascisme sinon une adolescence attardée ? » Et pourtant… Pourtant, Fellini reconnaît aussi : « je m’identifie à lui… Pas dans le sens de l’amant des femmes, mais dans le sens d’un homme qui ne peut pas aimer les femmes tant il aime une idée fantastique des femmes. »
pas terminé...
http://www.critikat.com/Federico-Fellini.html?artsuite=4
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue le 13 Novembre 2012 à 21:59

Federico Fellini est un réalisateur de cinéma et scénariste italien né à Rimini dans la région d'Émilie-Romagne en Italie le 20 janvier 1920 et décédé à Rome (Italie) le 31 octobre 1993 à l'âge de 73 ans.
Les relations passionnelles et conflictuelles qu'il entretient avec les femmes et son pays natal, l'Italie (deux des thèmes majeurs du cinéma fellinien), marquent la plupart de ses films.

Filmographie
- 1950 : Les Feux du music-hall (Luci del varietà) co-réalisation de Fellini et Alberto Lattuada avec Peppino de Filippo, Giulietta Masina
- 1952 : Le Cheik blanc ou Courrier du cœur (Lo Sceicco bianco) avec Alberto Sordi, Giulietta Masina
- 1953 : L'Amour à la ville (L'Amore in città) co-réalisation de Fellini, Michelangelo Antonioni, Dino Risi et Alberto Lattuada : épisode Une agence matrimoniale (Agenzia matrimoniale)
- 1953 : Les Vitelloni (I Vitelloni) avec Alberto Sordi
- 1954 : La Strada avec Giulietta Masina, Anthony Quinn
- 1955 : Il Bidone avec Giulietta Masina
- 1957 : Les Nuits de Cabiria (Le Notti di Cabiria) avec Giulietta Masina, François Périer
- 1960 : La Dolce vita, parfois intitulé La Douceur de vivre avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée
- 1962 : Boccace 70 (Boccaccio '70) co-réalisation de Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli et Vittorio De Sica : épisode Les Tentations du docteur Antonio (Le Tentazioni del dottor Antonio) avec Anita Ekberg
- 1963 : Huit et demi (Otto e mezzo), avec Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Claudia Cardinale, Anouk Aimée
- 1965 : Juliette des esprits? (Giulietta degli spiriti) avec Giulietta Masina, Sandra Milo, José Luis de Vilallonga, Valentina Cortese, Sylva Koscina, Mario Pisu
- 1968 : Histoires extraordinaires, co-réalisation de Roger Vadim, sketch Metzengerstein, Louis Malle, sketch William Wilson et Fellini, sketch Il ne faut jamais parier sa tête avec le diable, avec Terence Stamp
- 1969 : Block notes di un regista (A director's notebook) documentaire avec Fellini lui-même, Giulietta Masina, Marcello Mastroianni
- 1969 : Satyricon?, également intitulé Fellini-Satyricon avec Martin Potter, Hiram Keller, Magali Noël, Capucine, Alain Cuny
- 1970 : Les Clowns (I Clowns) avec Annie Fratellini
- 1972 : Fellini Roma? ('Roma) avec Anna Magnani
- 1973 : Amarcord avec Magali Noël
- 1976 : Le Casanova de Fellini (Il Casanova di Federico Fellini) avec Donald Sutherland
- 1979 : Répétition d'orchestre (Prova d'orchestra)
- 1980 : La Cité des femmes (La Città delle donne) avec Marcello Mastroianni
- 1983 : Et vogue le navire... (E la nave va...) avec Pina Bausch
- 1985 : Ginger et Fred (Ginger e Fred) avec Giulietta Masina, Marcello Mastroianni
- 1987 : Intervista avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg
- 1990 : La Voce della luna parfois intitulé La Voix de la lune avec Roberto Benigni
Biographie
Issu d'une famille de la petite bourgeoisie de province, Federico Fellini est né dans la station balnéaire de Rimini, sur la côte adriatique. Attiré par le journalisme et par le dessin de presse, il s'installe, en 1939, à Rome où il se fait engager dans un hebdomadaire humoristique à grand tirage.
Il a écrit une série de nouvelles destinées à être dites à la radio. L'une des « lectrices » est Giulietta Masina. Lorsqu'il la rencontre, c'est le coup de foudre : il l’épouse le 30 octobre 1943.
Il débute au cinéma comme script et comme assistant-scénariste de Roberto Rossellini pour le film Rome, ville ouverte (Roma, città aperta) en 1945. Si cette collaboration dure plusieurs années, Fellini travaille également aux côtés de Pietro Germi (Au nom de la loi, In nome della legge en 1948) et d'Alberto Lattuada (Sans pitié, Senza pietà en 1947). C'est avec ce dernier qu'il réalise sa première véritable mise en scène, Les Feux du music-hall (Luci del varietà) en 1951, une œuvre fortement influencée par le courant néoréaliste.
En 1952, il assure seul la réalisation de la comédie du Cheik blanc (Lo Sceicco bianco), puis tourne en 1953 Les Vitelloni (I Vitelloni), imposant définitivement l'univers fellinien.
C'est à La Strada, en 1954, que Federico Fellini doit son succès international. Dans ce film, comme dans Il Bidone en 1955 et dans Les Nuits de Cabiria (Le Notti de Cabiria) en 1957, il met en vedette sa femme, Giulietta Masina. Dans le premier film, elle joue le rôle de Gelsomina, une misérable artiste de cirque, brutalisée par Zampanò, le directeur de la troupe (Anthony Quinn), et, dans le dernier, celui de Cabiria, une prostituée courageuse, mais naïve.
La Dolce vita en 1960, qui obtiendra une Palme d'or au festival de Cannes, est un tournant décisif : il impose définitivement ce qu'on appellera désormais (souvent à tort et à travers) le baroque fellinien, qui définit notamment les personnages (exubérants, extravagants, véritables caricatures vivantes), la narration (pas de réelle progression dramatique) ou le traitement du temps (le réel et l'imaginaire s'entremêlent allègrement).
L'énorme succès de La Dolce vita, dont la musique lancinante signée Nino Rota allait faire le tour du monde, lui permet de réaliser, trois ans plus tard, son film le plus personnel et le plus ambitieux, Huit et demi (Otto e mezzo). En livrant ainsi ses angoisses et ses fantasmes de cinéaste à travers son « double cinématographique » Marcello Mastroianni, Fellini propose une réflexion passionnante sur la création artistique.
Après la démesure de son Satyricon en 1969, d'après l'œuvre de Pétrone, Fellini, désormais débarrassé de l'héritage néoréaliste, plonge dans ses souvenirs d'enfance avec Les Clowns (I Clowns) en 1970, téléfilm sorti aussi dans les salles de cinéma, Fellini Roma en 1972 et, surtout, Amarcord en 1973, qui évoque son adolescence à Rimini, sa ville natale.
Avec Le Casanova de Fellini (Il Casanova di Federico Fellini) en 1976, il renoue momentanément avec le baroque fastueux du Satyricon. Mais sa veine intime reprend le dessus, avec un nouveau téléfilm qui sera également exploité dans les salles de cinéma : Répétition d'orchestre (Prova d'orchestra) en 1979.
Les années 1980 s'ouvrent sur La Cité des femmes (La Città delle donne) en 1980. Suivront Et vogue le navire... (E la nave va...) en 1983, véritable opéra funèbre, Ginger et Fred (Ginger e Fred) en 1985 et Intervista en 1987.
C'est avec La Voce della luna, en 1990, un film au climat crépusculaire - ce qui lui donne, retrospectivement, un aspect étrangement prémonitoire - que se clôt l'activité cinématographique de Fellini.
Principales récompenses
- 1953 : Lion d'argent à la Biennale de Venise pour Les Vitelloni
- 1954 : Lion d'argent à la Biennale de Venise pour La Strada
- 1956 : Oscar du meilleur film étranger pour La Strada
- 1957 : Oscar du meilleur film étranger pour Les Nuits de Cabiria
- 1960 : Palme d'or au festival de Cannes pour La Dolce vita
- 1960 : David di Donatello d'or de la meilleure réalisation pour La Dolce vita
- 1961 : NYFCC Award du meilleur film étranger pour La Dolce vita
- 1963 : Oscar du meilleur film étranger pour Huit et demi
- 1963 : Grand Prix du festival de Moscou pour Huit et demi
- 1965 : NYFCC Award pour Juliette des esprits
- 1972 : Grand Prix de la Commission Supérieure Technique au festival de Cannes pour Fellini Roma
- 1974 : Deux David di Donatello d'or (meilleur film et meilleure réalisation) pour Amarcord
- 1974 : Oscar du meilleur film étranger pour Amarcord
- 1984 : Deux David di Donatello d'or du meilleur film et du meilleur scénario pour Et vogue le navire...
- 1987 : Grand Prix du Festival international du film de Moscou pour Intervista
sources
http://ann.ledoux.free.fr/pmwiki/index.php5?n=Main.FedericoFellini
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Dona Rodrigue